La photo jaunie d’un enfant d’une dizaine d’année, le regard droit vers l’objectif, ses yeux noirs posés sur le monde, déjà avec une tranquille assurance. Ce sont les années 30, celles de l’insouciance adolescente encore, quand avec son frère aîné, Norbert, Maurice-David Matisson formait l’extraordinaire duo Bib et Bob, chanteurs de variétés, illusionnistes, des enfants artistes.…(1)
70 ans plus tard, c’est ce même regard sans faiblesse que porte sur le monde et les hommes, Maurice-David, partie civile du groupe de tête contre Papon avec Michel, Juliette, Esther, René, ceux d’ici, de Mériadeck, la bande omniprésente, les coudes serrés, en bisbille souvent mais toujours solidaires quand il s’agit de l’essentiel.

Bib, l’aîné fit une carrière de violoniste. Bob, fasciné par Molière voulut devenir comédien. Apprenti chez Dullin, acteur pour Raymond Rouleau, metteur en scène et rôle-titre d’un Ubu roi, psychothérapeute, il utilisa toujours le jeu de l’acteur, les jeux de rôle dans sa pratique thérapeutique.
Entre ce Bob prêt à croquer la vie et le vieux monsieur malade du cœur, plus d’un demi-siècle passé à combler ce vide, à mettre des mots sur la fracture, sur la dénégation d’existence que fut la Shoah… M.D Matisson a perdu 8 des siens dans cette tragédie. Dans les années 10, les Matisson avaient fui Riga en Lettonie, chassés par la persécution tsariste. Ils furent de ces juifs russes qui en 14 comme en 39 se sont engagés pour défendre ce pays des Droits de l’homme, qu’ils avaient choisi pour cette qualité-là justement. En 40, M-D Matisson avait 14 ans, dans ses années d’adolescence, il lui fallut grandir à marche forcée pour prendre en charge les siens, assurer des replis, et combattre dans la résistance jusqu’à l’ultime libération de la poche du Verdon.
Pour « ce juif français errant dans le siècle », le procès a rendu aux victimes cette citoyenneté que les nazis et leurs servants français leur avaient confisquée. Psychothérapeute, spécialiste du jeu de rôles, auteur avec Jean-Paul Abribat d’un important ouvrage publié en 91 et intitulé « Psychanalyse de la collaboration », qu’il cite à plusieurs reprises dans ce très long entretien.

D’abord, comment avez-vous apprécié la sanction et quel en fut le rôle pour les victimes ?
La sanction est très importante bien qu’elle le soit moins que celle qu’on aurait souhaitée. Mais la condamnation d’un haut fonctionnaire de Vichy devenant par un tour de passe-passe à la Fregoli, un ministre et pas des moindres -je rappelle quand même qu’il avait été pressenti pour être 1er ministre dans les mois qui suivaient la révélation de l’affaire- pour un homme comme cela, être condamné à 10 ans, ce n’est pas rien. Pour les victimes, c’est très important, d’abord parce que c’est la dénonciation d’un crime abominable, « un crime de bureau » comme le dit Gérard Boulanger. Mais derrière cela, c’est tout le régime de Pétain qui est atteint. Car le statut des juifs élaboré dès l’arrivée de Pétain au pouvoir, ce fut l’annulation symbolique des juifs, et après, on a pu les éliminer matériellement si j’ose dire. Plus le droit d’être citoyen, plus le droit de travailler, plus le droit au transport, plus le droit d’aller dans certains cafés. Le Régent à Bordeaux affichait : « interdit aux juifs et aux chiens. » Cela prouve qu’on n’était pas seulement des untermenschen comme les Allemands disaient mais c’était la mort sociale telle que la définissait une loi de 1854 qui s’appliquait aux grands criminels. A peu près ce qu’on faisait au Moyen Age pour des lépreux et encore ! Donc la sanction vient nous restituer dans notre citoyenneté. Le lendemain de la sanction, j’ai d’ailleurs enlevé toutes mes décorations de toutes mes vestes. Pourquoi ? Parce que, moi, en tant qu’homme je ne suis pas un porteur de décoration, je les ai portées pendant 17 ans pour montrer que nous étions citoyens français. Mais je n’ai plus rien à prouver maintenant, je suis redevenu un citoyen français comme tout le monde. Et ça c’est extraordinaire car on ne peut pas imaginer ce que représente pour un être humain le fait d’être éliminé du regard des autres ou d’être montré du doigt, d’avoir à porter l’étoile infamante, il faut savoir ce que cela signifie. Moi je l’ai portée à 16 ans, avec mes copains du lycée, mes copains proches, pas de problème. Mais le premier jour où je l’ai mise en allant au lycée de la Place de la République au Boulevard Bonne Nouvelle, les regards étaient divers, indifférents, agressifs ou apitoyés. La sanction donc vient nous ramener dans le champ de la citoyenneté car quelqu’un qui est montré du doigt, qui est éliminé, qui se sent de trop, il doit se dire quelque part » qu’est-ce que j’ai bien pu foutre, -surtout quand on est un enfant- pour être châtié de cette manière.» Et puis, 2ième point : ce que nous avons vécu pendant 17 ans. Les gens ont cru que le procès Papon, c’était du folklore qui n’aurait duré que 6 mois ! C’est vrai que cela a été dur, pénible, une ascèse, une psychothérapie à 400 personnes, vous et moi y compris. Et pour les victimes, qui ont fait ce qu’elles devaient, les victimes qui étaient là tous les jours, tous les jours, ce qui montre l’ampleur de leur attente et aussi les raisons du succès de la sanction. Au prix de tout cela, se sont révélées des solidarités, des mises au clair historiques. Et tout cela fait que les plaignants sont sortis du procès Papon non en cocorico : « j’ai gagné », mais seulement avec le sentiment d’y voir plus clair dans leur passé, d’avoir appris des choses sur leurs parents…

Pourtant, vous considérez que le traumatisme des victimes et de leurs descendants n’avaient pas été pris assez en charge par le procès.
Ce ne sont pas seulement les victimes, c’est toute la France. Il y a un non-dit qui est inhérent à l’ampleur de l’horreur. Moi personnellement, cela a été un peu différent, ce qui explique que tous mes enfants se sont portés partie civile parce que j’en ai toujours parlé chez moi. Pas en tant qu’ancien combattant rabâchant mais pour les informer. Car je savais du fait de mon expérience professionnelle combien l’ignorance des traumatismes des parents et des grands-parents, lorsqu’ils ne peuvent pas être élaborés psychiquement par leurs enfants peuvent être la source de troubles plus ou moins importants. Or même dans ma famille, pour certains enfants qui me l’ont « reproché » (je l’ai évoqué dans mon livre Psychanalyse de la résistance), je ne les aurai pas assez informés sur l’affreuse tragédie que notre famille avait vécue, malgré l’effort que j’avais pu faire en ce sens. C’est qu’en effet, quand une violence historique de cette ampleur s’abat sur un individu, la scission psychique qui se produit sur le plan émotionnel devient prédominant par rapport au sens même du contenu de cette violence. C’est pourquoi j’ai déploré que durant le procès, l’avis d’un expert sur ces questions,comme Tobie Nathan, n’ait pas pu se faire entendre. Si la plupart des médias ont donné une large place à la souffrance exprimée par les parties civiles, rares sont ceux qui ont tenté d’expliquer la nature de cette souffrance sauf le Monde qui a publié une page entière sur ce thème. …
Comment l’avez-vous vécu dans votre propre famille? Vous avez beaucoup de victimes directes, des trous dans votre arbre généalogique.
Bien sûr, c’est pourquoi, avec mon épouse quand nous nous sommes mariés, (dans un mois nous fêtons nos noces d’or), nous nous sommes dit : nous aurons 5 enfants. Chez moi, on était 4, chez elle 3, on en voulait 5, c’était la volonté de redonner vie à cet arbre secoué par l’orage et dont des branches avaient disparu. Chez mes enfants, le même phénomène se reproduit. Ma fille aînée a 3 enfants, mon fils aîné en a 4 alors que pour leurs conjoints, cela n’était pas évident.
Vous vous définissez dans votre livre comme un juif français sans religion errant dans le siècle…
… La première raison du juif français, c’est que je suis né là-dedans, un peu comme Astérix et la potion magique. J’ai baigné toute mon enfance dans les récits de guerre de mon père, il avait fait la guerre de 14 depuis le premier jour et jusqu’à l’armistice et même un peu plus! Il s’est comporté vaillamment, en tout cas ses citations, sa croix de guerre le montrent pour nous. Il n’y a jamais eu de problème, même pas du fait de la langue russe, que parlaient mes parents. Quand ils sont arrivés en France, ils ne parlaient que le russe, ma mère parlait un peu de polonais et d’allemand, mon père aussi un peu d’allemand mais c’est surtout à travers le yiddish. Pourtant dès qu’ils ont eu des enfants, on parlait français à la maison, le russe était réservé aux moments où il fallait dire des choses qu’on ne devait pas comprendre. La lumière s’est faite le jour où mon père d’un air très content disait à ma mère « malick ! malick ! » j’ai fini par savoir que cela voulait dire: regarde le petit ! » . On était vraiment installé en France et mes parents se sentaient français bien que mon père n’ait été naturalisé pour des raisons matérielles qu’après la libération. On le lui avait déjà proposé après la guerre de 14/18.
Au niveau de l’absence de religion, même chose, mon père faisait partie de ces juifs sans religion qui étaient beaucoup plus nombreux qu’on ne le croyait. Mon père appartenait au Bund, c’était un mouvement révolutionnaire plus proche des bolcheviques que des mencheviks, ce qui les séparait, c’était la judéité. Mon père était comme des milliers de juifs européens, les ashkénazes, des révolutionnaires. Quand on voit ce qu’est Israël aujourd’hui, avec ses intégristes religieux, on a oublié que ceux qui l’ont constitué étaient tous des révolutionnaires non religieux. D’ailleurs la résistance des kibboutz le montre. A la maison, on allait à la synagogue une fois par an parce que ma mère était plus superstitieuse que religieuse et fille de rabbin. Elle avait l’impression de trahir son père si pour Yom Kippour, au moins, on n’allait pas à la synagogue. Mon père qui était un brave homme, ne voulait pas d’histoire avec sa femme, alors on y allait.
Le juif errant, c’est vrai que j’ai erré. Parti de Bordeaux, j’avais 6/7 ans, ensuite Paris, notre errance pour nous sauver en 1942 avec les petits enfants de ma sœur déportée. Après, pour moi, ce fut la guerre, et ensuite il a fallu que je me coltine… avec la vie ! A 20 ans, je n’avais pas le bac, j’avais un niveau de bac, mais je n’avais pas le bac, je n’avais pas de métier. Mon métier, avant-guerre, c’était d’être enfant artiste mais à la libération, ce n’était pas possible de continuer dans ce sens car tout en France était à reconstruire. Alors j’ai fait du théâtre amateur et engagé et j’ai erré du point de vue professionnel. Au début, j’ai travaillé avec l’armée américaine, mais le deuxième jour, je suis parti, j’étais assez caractériel, il ne fallait pas me marcher sur les pieds. J’avais trouvé un emploi pour faire l’inventaire des conserves américaines qui partaient en camion de Bercy. Il y avait des quais, des camions, je baragouinais un peu d’anglais, c’était assez facile. Le lendemain de mon embauche, j’ai dû faire une petite erreur et le gradé américain s’est permis de me dire : » Ah vous ! les Français, tous pareils… » il a à peine eu le temps de finir sa phrase qu’il avait mon poing sur la figure, il est tombé entre deux camions et le soir j’étais remercié. A l’époque, c’était comme çà. Après, j’ai travaillé comme chasseur dans un cabaret de Montparnasse qui était tenu par un mac très sympathique, du milieu corse. Mais, ça c’est fini de la même façon, j’étais très instable, je ne suis resté que quelques jours. Il a fallu que je trouve du travail. En 1947, comme rien ne se révélait à Paris, je suis revenu à Bordeaux avec mon parrain, qui m’a dit : « Viens, on va se débrouiller. » Là, j’ai saisi une deuxième chance, celle de rentrer au journal les Nouvelles de l’époque, C’était pas Sud Ouest mais il le serrait de près quant au nombre de lecteurs. Grâce à mon travail, je me suis retrouvé secrétaire de rédaction à la « Une «. C’est enviable, j’avais appris le métier de journaliste, je pensais bien continuer. Je suis resté au journal 8 ans. Mais c’était un peu l’enfer ! On partait une fois que la dernière édition était tombée, sur le coup de deux heures du matin. Quand il y avait un match, comme celui de Cerdan en 1947 c’était 4 heures et à sept heures il fallait réembaucher. Et puis, on était peu nombreux, nous étions des militants. Jusqu’au moment où mon cardiologue m’a dit « petit, tu changes de métier ou tu es mort dans six mois ! » Ce fut une catastrophe ! C’est pourquoi j’ai employé le mot errant, car j’ai dû faire beaucoup de choses. Je suis allé me reposer à Noyon dans l’Eure où vivaient mes parents et là j’ai rencontré quelqu’un qui y était établi avec sa famille depuis des années. Il avait été résistant et dans ma compagnie pendant la guerre. Il était VRP, et vendait des engrais là-bas en Picardie chez des fermiers à la tête de milliers d’hectares. Il me dit : « tu verras, c’est bien, on se la coule douce, quand on connaît les gens, tout se fait par téléphone… » Le commerce, c’est pas mon truc mais quand même, à l’époque j’avais 3 gosses, et il fallait bien faire bouillir la marmite. Je me lance donc dans l’engrais jusqu’au moment où j’ai eu un emploi d’éducateur, J’ai trouvé une voie que j’ai poursuivie jusqu’au bout. Il a fallu que je passe des examens : éducateur, puis éducateur spécialisé en 1960. A l’issue de mes examens, mes profs m’ont dit de continuer. C’est comme ça que j’ai commencé mes études de psychologie, j’ai passé ma licence. Il n’y avait pas de maîtrise à l’époque, on passait une licence en 5 certificats, avec propédeutique. Mais avant, il m’a fallu réussir l’examen d’entrée en fac et j’ai continué la licence, puis une thèse qui correspondait au DESS d‘aujourd’hui et enfin mon doctorat que j’ai passé dans les années 70. Quand je dis errance, c’est pas un vain mot.
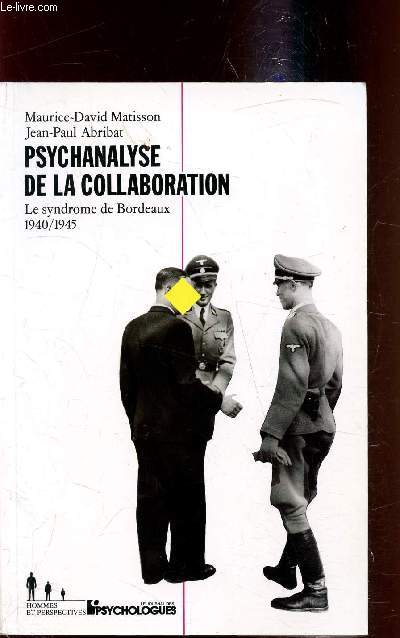
Vous décrivez là l’errance sociale et professionnelle, mais il y eut aussi ce traumatisme initial ?
Du fait de ma profession mais aussi du fait de ce que je ressentais à l’époque, en 1962, j’ai commencé une psychanalyse. Elle s’est poursuivie jusqu’en 1974 en 3 tranches. Elle n’a pas tout réglé mais disons qu’elle m’a permis de prendre un peu de distance avec ce que m’était arrivé. Et puis en 1964, j’ai entrepris une seconde initiation qui n’est pas terminée, (elle ne peut se terminer que les pieds devant) et sur laquelle je ne veux pas m’étendre mais les gens de Bordeaux me connaissent assez pour savoir de quoi je parle… J’ai pu installer cette errance socio-économique et ma conception des choses dans ma manière d’être. C’est à dire que je me sens plus au service des gens que parmi les gens pour me servir d’eux et ça c’est un sentiment merveilleux. Même au niveau de ce qui s’est passé durant le procès, ma prudence de langage et même ma vivacité de langage n’ont jamais dépassé les limites de ce que j’appellerai la compassion même vis à vis de Papon.
Vous êtes aussi, dites-vous dans votre livre « Matisson, le fils de Mathieu », celui qui porte sa blessure à son côté.
Oui, il s’agit de mon cœur. Çà date de l’époque, j’étais très jeune, où je faisais de la danse russe. Une vraie danse russe, pas un truc de gosse! Je faisais des sauts d’un mètre, cinq tours sans mettre les pieds à terre, c’était une performance que mon père m’avait transmise. La cardiologie à l’époque, c’était rudimentaire » Jamais plus de sport » m’avait-on dit. Ça, ça m’a gêné. Je faisais malgré tout de l’escrime comme tous les jeunes. Même pour m’engager dans l’armée, il a fallu que je mente. Il est vrai que le contrôle médical à l’entrée dans l’armée à cette l’époque n’était pas exigeant. Cette histoire de cœur m’a suivi longtemps. D’abord en 1952 ou 53 quand j’ai dû arrêter mon activité de journaliste que j’espérais pratiquer toute ma vie. Et ensuite en 1980, j’ai dû subir une opération à cœur ouvert, je n’avais pas 50 ans. Malgré cette valve en carbone carbone indestructible j’ai dû subir en 1994, une deuxième opération à cœur ouvert
Vous êtes psychothérapeute. Vous avez donc un regard analytique sur cette période. A propos de la Shoah, Rothko, le peintre juif russe, exilé aux États unis, disait qu’on ne pouvait plus, après la Shoah représenter l’humain ?
Je lui donne raison. Lanzmann, l’auteur du film « Shoah » le dit très bien: on peut trouver toutes les explications historiques, c’est vrai, il y en a, on l’a vu au procès, on peut ramifier les choses; mais ce qu’on ne peut pas expliquer, c’est l’horreur du passage à l’acte. La manière dont ce passage à l’acte s’est effectué. Je suis contre tous les génocides. Il y a eu les Khmers Rouges et Pol Pot, énorme du point de vue du nombre de victime. On peut parler du Rwanda aussi. Je suis de toutes les actions autant que je le peux contre cette nature du mal qui prend des dimensions extravagantes qui fait qu’on ne peut plus se représenter l’homme après ça.
Mais, la différence avec la Shoah et je ne dis pas pour dire : la Shoah etc. parce que je suis juif, non. Mais quand on a bien étudié la manière dont les nazis ont systématisé et industrialisé la Shoah, la façon dont ils ont officialisé dans leurs textes légaux qui la justifient, toute cette machination fait que c’est un génocide hors de proportion et impensable. Voilà, c’est de l’ordre de l’impensable. Et je voudrais dire à ce sujet ce que je répète mais qu’on n’entend pas, en général pour des raisons religieuses, autant chez les juifs, chez les chrétiens, que chez d’autres et que je ne supporte pas, c’est l’emploi du mot holocauste. La Shoah n’a rien à voir avec un holocauste car on laisse entendre ainsi que les assassins seraient les officiants d’une cérémonie religieuse alors qu’il s’agit de vulgaires brigands représentatifs de ce qu’il y a de plus criminellement diabolique dans la nature humaine. Le génocide lui qualifie bien le crime commis par les nazis sans aucune connotation métaphysique. Il s’agit d’une violence historique sans précédent et donc irreprésentable dans l’esprit humain. C’est une espèce de cataclysme qui s’abat. C’est un peu ce qui nous est arrivé. Quand il y a une espèce de cataclysme qui s’abat non pas sur « les individus » mais sur un individu, sur chacun, on est tout seul. On ne sait plus où on est et comment ? C’est que le psychisme de l’individu subissant cette scission interne a perdu le contenu de ce qui s’est passé. Il en conserve la forme, le contenant qui a pris la place de tout le contenu. La forme de la déflagration historique prend le pas sur le souvenir de l’événement lui-même Et après dans sa vie quotidienne, elle se transmet, d’abord, elle travaille le sujet, ensuite, elle se transmet. C’est pourquoi, les voies habituelles de la psychothérapie sont insuffisantes, le procès de Papon lui, a joué ce rôle de remise en question de ce contenant en redonnant sens à ce contenu oublié, lui-même.
Vous évoquez là la capacité à s’en sortir individuellement mais la Shoah pose aussi le problème du devenir de l’Humanité, la question de l’Humanisme. A ce propos Georges Steiner parle de « transgression du principe de vie par le passage à la mort », ajoutant : « la raison ne nous donne aucune protection contre l’inhumain ».
Laissez-moi vous dire qu’il ne faut pas aboyer avec les loups et ne pas bêler avec les moutons ou si vous préférez une formule plus fine, il ne faut pas bêler avec les loups et aboyer avec les moutons. Il ne faut pas être suiviste ni vouloir abaisser les autres. Il faut être clair. Je ne suis pas un individualiste mais je refuse le communautarisme particulariste, l’appartenance dogmatique. C’est d’eux que vient la barbarie. Il faut être capable de franchir les frontières qui nous séparent des autres. Par exemple, ce qui se passe en ce moment avec ce que d’aucun appelle « les bougnoules », « les bicots » comme on disait « les youpins », ça m’horrifie, Et là, je serais prêt à reprendre un flingue et pourtant chaque homme peut comme ça se laisser aller naturellement à ses pulsions de haine. La seule solution c’est de se sentir à la fois seul en tant qu’unité de vie et à la fois solidaire par rapport à l’univers. Il faut accepter l’idée que l’univers prime sur le reste. Il faut accepter que la rivière soit de l’eau qui coule aussi bien en France qu’en Allemagne, que la terre n’est pas un drap qu’on se dispute. Je ne suis ni pour la loi du sang ni pour la loi du sol, je suis pour la loi qui permet à un être humain de vivre là où il se trouve, paisible et au travail. C’est la seule vérité profonde et c’est cette vérité qu’on est en train de brûler aujourd’hui avec les clans, avec le communautarisme excessif, y compris le juif. En revanche, je ne suis pas du tout contre le fait qu’on puisse appartenir, se sentir appartenir à la France sans en faire un nationalisme étroit : « je suis français donc je méprise les autres et à la limite je les tue « Non! Mon meilleur ami, un grand écrivain occitan, Félix Castan, que je connais depuis 1944, travaille pour l’Occitanie mais pas d’une manière étroite et bête. Pour lui, il y a des êtres humains qui partagent une même langue, une même manière d’être, de vivre. Derrière ça, il y a tout un réseau social, c’est quand même l’Occitanie qui a inventé la relation politique avec les citoyens et qui s’est opposé à la nationalisation des êtres. Refusant le cléricalisme, j’accepte qu’on soit juif, qu’on soit arabe mais en regardant l’autre comme un frère, pas comme un ennemi. On nous rebat les oreilles avec « tu aimeras ton prochain comme toi-même, » la formule hébraïque est encore plus exigeante qui dit » tu aimeras ton lointain, leera, leera, ton lointain comme toi-même. » Plus l’autre est loin, plus tu dois t’en rapprocher, apprendre à la connaître pour mieux l’aimer. Je crois que là est l’antidote et c’est pourquoi j’ai beaucoup d’espoir pour l’avenir malgré les difficultés du présent qui pourraient nous rendre pessimiste.
Vous parlez, le cas échéant de reprendre aujourd’hui les armes mais à l’époque, vous les avez prises. Et vous avez tenu à rappeler, pendant le procès, qu’il y avait des juifs qui avaient été des résistants, des combattants ?
Tous les mâles du procès sont passés par la résistance. Il est vrai que c’était plus difficile pour eux d’éviter cet élan patriotique que pour d’autres. Je ne veux pas dire que les autres étaient des moins que rien. On sait bien : tous les Français n’ont pas été des résistants. Je veux signifier que j’ai moins de mérite en tant que juif que par rapport à certains qui auraient pu rester chez eux tranquilles et qui ne l’ont pas fait. C’est bien cela que je reproche à Papon. Si Papon avait, du fait même de ses origines politiques, qui étaient les mêmes que celles de Jean Moulin, s’il avait eu la lucidité de se dire : j’obéis à Londres, je ne peux pas servir Vichy,il serait resté un homme honorable et non pas un gesticulateur du langage qui veut faire croire que, parce qu’il a des titres, il est exonéré de toutes ses vilenies. Il n’y a pas de raison d’état excusable quand il s’agit de la vie d’un homme et à fortiori de toute la population juive de Bordeaux. La raison d’état, la raison d’appartenance à un journal, d’appartenance à l’establishment, pour moi ça n’existe pas. Voilà le sens de ce que j’appelle dans mon livre la victoire des David de Mériadeck sur les Goliath…
Ceux qui ont porté ce procès, ce sont ceux de Mériadeck ?
Oui, ma famille a été le starter. C’est ma mère, ma cousine Fogiel, mon fils Jean -Marie et moi, et très vite derrière mes neveux, mes nièces, 10 en tout qui furent les premiers plaignants déclencheurs du procès comme Michel Slitinsky en a été le déclencheur dans l’opinion publique. Tous des gens de Mériadeck. La communauté de Mériadeck s’était mise en porte à faux vis à vis de la communauté juive de Bordeaux qui était tenue par des gens qui étaient riches et partageaient la même conviction séfarade de la religion pratiquée en Afrique du Nord. Mais les ashkénazes, c’étaient des gens comme mes parents, ils arrivaient d’Europe centrale ou comme mon père de la guerre avec son pécule de démobilisation. Pas de maison, pas de meuble, pas d’argent, ils se retrouvaient naturellement là où c’était le moins cher de se loger : à Mériadeck. Les gens de Mériadeck, pour la plupart, c’étaient des gens comme ça. C’étaient les banlieues d’aujourd’hui. Des banlieues au sens où il y avait de la bagarre à Mériadeck. C’était l’enfer pour un enfant de mon âge, j’avais 4 ans à l’époque, c’était l’enfer mais en même temps il y avait une communauté de fraternité entre les êtres. On se demandait pas si on était juif, catholique, arabe, on jouait ensemble, on partageait les mêmes jeux et les mêmes lieux.

L’enfer?
L’enfer, c’étaient les maisons closes quand j’allais à l’école Anatole France, Il y avait 5 ou 6 bordels rue Dalon et des régiments de Sénégalais qui faisaient la queue. L’un rentrait quand l’autre sortait. Les enfants que nous étions ne comprenaient pas bien de quoi il s’agissait. Mais peu à peu, par la rumeur, on a compris. Il y avait aussi des crimes, des gens qui se faisaient égorger, j’en ai vu. C’était vraiment une horreur pour un enfant, on a du mal à se l’imaginer. Mais par contre, quand quelqu’un était dans la mouise, on avait pas besoin d’aller au bureau de la mairie ou ailleurs. L’un sortait son chapeau et chacun y mettait un billet ou deux et ça tournait. Le soir, la famille avait de quoi manger pendant 8 jours. Je veux dire qu’il y avait du cœur et un sens de l’honneur. A Mériadeck, quand on avait donné sa parole, on avait pas besoin de l’écrire sur un contrat.
Vous avez conclu tout à l’heure sur ce pessimisme face à la situation actuelle. Quel regard portez-vous sur votre propre histoire, comment vous a-t-elle constituée ?
Je vais vous donner un regard de thérapeute. Tout être humain peut bénéficier d’une analyse ou d’une thérapie, si elle est menée comme il le faut, par des gens qui viennent se former ici, au Circe (2) des psychiatres, des psychologues, des assistantes sociales, qui le font depuis 28 ans. Tout être humain qui souffre peut bénéficier d’une analyse ou d’une thérapie. Pour bien former ceux qui s’occupent des autres, il ne faut pas les enfermer dans des vues dogmatiques mais créer pour eux un lieu où ils se sentent écouter par une personne qui a de l’expérience dans ce domaine. Tout être humain qui souffre doit pouvoir bénéficier d’une thérapie, ces personnes souffrant de traumatisme plus ou moins grand, des êtres incapables de se relier aux autres, sans être autistes forcément, mais incapables de nouer des liens humains, et qui se ferment dès que les autres approchent ou répondent par l’agressivité. Ce sont des gens qui souffrent parfois le martyr. Parmi les patients que j’ai connus, ceux qui étaient le plus dissocié ont parfois réussi à se libérer de leur souffrance. Pourquoi ? Il y a les gens qui souffrent parce qu’ils sont étouffés, étouffés par leurs parents, par leur milieu. Ils ne supportent pas cette espèce d’étranglement, ils mettent un temps fou à se défaire de cette impression d’être assiégé dans leur château personnel. Souvent, ils s’en sortent plus ou moins bien alors que la personne dont les murs sont totalement délabrés, et où on peut pénétrer de partout, fait l’économie de résister. Elle n’a plus besoin de faire tomber les mauvais murs ou ressentis comme tel et elle débouche souvent vers une indépendance d’esprit et une ouverture vers les autres moins hésitante. Je crois que pour les juifs, ils se sont retrouvés après la Shoah dans une maison où il n’y avait pas de mur et où ils se sentaient à tout vent !
Entretien Jean-François MEEKEL
1 “Maurice est le plus jeune des deux et Norbert, son frère le plus âgé. De mémoire, ils ont participé à la première émission radiophonique diffusé sur Radio Paris, ils ont été à l’école de la musique avec Mouloudji et Aznavour et ils ont joué dans le premier film de la guerre des boutons avec Aznavour.” (précisions de Jean-Marie Matisson)
2 : C.I.R.C.E: Centre d’Initiation à la Relation par la Créativité et l’Expression fondé par M.D Matisson en 1971, un lieu de recherches autour du psychodrame qui s’adressent à des gens déjà engagés dans des pratiques thérapeutiques. De nombreux textes ont été publiés aux Editions du CIRCE ainsi que des cahiers du même nom. Par ailleurs MD Matisson est l’auteur de nombreux ouvrages dont Psychanalyse de la collaboration. Le syndrome de Bordeaux 1940-1945 avec JP Abribat.
Maurice David Matisson est mort à Bordeaux le 29 juin 2000, il avait 74 ans. La commune de Sainte Géneviève-des-Bois dans l’Essonne a donné son nom à une rue.
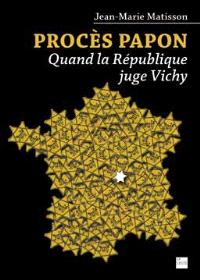
Ce texte a déjà été publié intégralement sur le site de Jean-Marie Matisson http://www.matisson.com/affaire-papon/index02.php, qui propose une vraie mine d’information autour de l’affaire et du procès Papon.


No responses yet